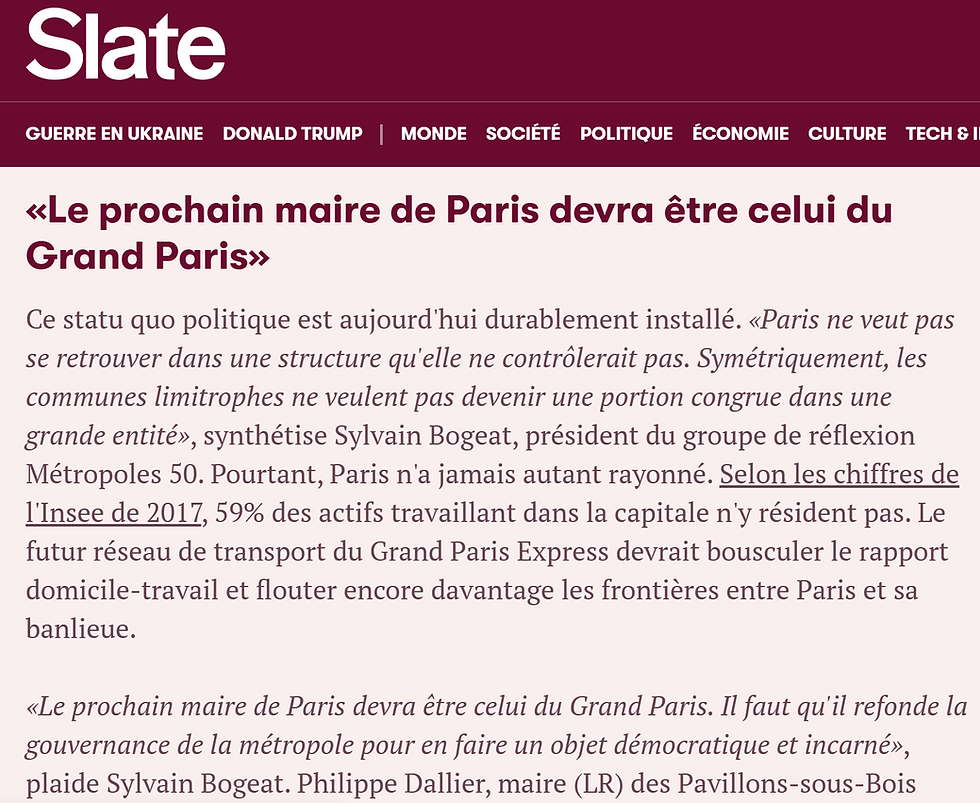Ce que la polémique sur le coût des transports nous révèle sur l'organisation des JO 2024
- Christophe Ari-Roux
- 10 janv. 2024
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 janv. 2024
Touristes ou locaux, qui va payer la note des transports franciliens ? La promesse de rendre les transports gratuits n’a pas été tenue. Contrairement à Londres, Pékin ou Athènes, Paris n’aura pas réussi à tenir son engagement en la matière. Cette polémique est-elle la partie visible de l’iceberg, cachant une profonde difficulté des pouvoirs publics à travailler conjointement pour dans le cadre de l’organisation de méga projets comme les Jeux Olympiques ?
Accueillir les Jeux Olympiques constitue l’opportunité de repenser la ville et son développement ultérieur (schéma directeur, aménagement, infrastructures, plan d’occupations des sols). Comme l’ont montré R. Gold et Margaret M. Gold (2007), les Jeux Olympiques permettent la construction de nouveaux équipements sportifs et l’amélioration des liaisons entre ces sites en intervenant sur les moyens de transport, comme le métro.
Pour organiser les Jeux Olympiques 2024, 32 maîtres d’ouvrages différents ont œuvrés, dont l’Etat, les Villes de Paris et Marseille, la Métropole du Grand Paris, les départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ou encore la Région Île-de-France. Autant d’acteurs publics, que de sensibilités politiques pour construire une vision commune. Mais hétérogénéité n’est pas impossible. L’organisation des Jeux de Barcelone (1992) est un bon exemple. La ville a été capable de réinventer l’ancienne ville et de faire converger les intérêts à court terme de l’organisation olympique avec la planification urbaine à plus long terme de la ville. Au-delà de la rénovation des quartiers anciens et de la construction d’enceintes sportives, Barcelone a construit 35 nouveaux kilomètres de routes, 4.500 appartements issus du village olympique et deux tours de communication. La ville a pris une signification nouvelle et elle est devenue un projet qui associe les priorités locales de développement et des objectifs plus globaux.
Les Jeux Olympiques sont devenus un véritable outil de transformation des métropoles mondiales. La régénération urbaine prend donc de l’importante sous l’effet des gouvernants locaux et avec le concours du CIO qui en fait un critère important de sélection des villes pour le CIO (Davies, 2010). Cette notion de mégaprojet pose le problème de l’évaluation des coûts et recettes (Flyvberg 2007). Outre les nombreux risques financiers, sociaux et environnementaux, c’est aussi les contingences locales qui peuvent desservir le projet.
Dans le cas des Jeux Olympiques de Paris, la gratuité des transports est un bon exemple. C’était une promesse du dossier de candidature. Athènes, Pékin et Londres ont réussi le pari de rendre les transports en commun gratuits pour les détenteurs de billets pour les épreuves. L’offre de métro, RER et bus augmentera de 15% pendant la période des JO. Ce qui implique indirectement un coût supplémentaire de 200 millions d’euros.
Le porte-parole de Paris 2024 Michaël Aloïso a rappelé que la promesse de gratuité a été abandonnée depuis décembre 2022, en lien avec la volonté de maîtrise budgétaire et le contexte actuel d’inflation. Cette décision, passée inaperçue à l’époque, s’est transformée en véritable polémique avec la déclaration de la Présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse (LR), annonçant un doublement du tarif du ticket de métro (4 euros pour le Ticket T+ de base contre 2,10€ actuellement, 32 euros le carnet de dix billets contre 16,90 en temps normal).
La décentralisation des compétences et leurs enchevêtrement complique la mise en cohérence de la décision politique, sans parler du jeu de posture inhérent à une pluralité d’acteurs politiques, aux sensibilités variées. Les occasions de confrontation sont multiples. La Ville de Paris qui n’a pas la compétence des transports martèle que les transports publics ne seront pas prêts à l’ouverture des jeux. « On est quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n’arrive pas à rattraper le niveau […] de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisien ». Elle propose de surcroît de limiter la vitesse sur le périphérique parisien à 50km/h après les JO et de réserver une voie pour les bus et le co-voiturage. A l’inverse, la Région Île-De-France s’oppose à cette dernière proposition et souhaite évidemment rassurer sur l’offre de transport. Ces rivalités politiques pèsent évidemment sur les JO 2024, tout autant que l’inertie propre aux grands projets. La création de nouvelles lignes de métro dont la 15, 16 et 17 en est un bon exemple. Aucune de ces trois lignes ne sera prête le jour de l’ouverture des jeux, pas plus que le CDG express... Seul le prolongement de la ligne 14 sera effectivement livré avant les Jeux olympiques.
Cette polémique anecdotique montre les limites en matière de décentralisation lorsqu’il s’agit de réformer ou de coordonner des grands projets. L’Etat ne peut pas se défausser de ses responsabilités sur les collectivités locales dans ce cadre et doit conserver un rôle de premier plan dans ces contextes, qui lui permettra par ailleurs de continuer à asseoir sa légitimité et d’éviter une trop forte dispersion des collectivités dans des domaines qui dépassent leurs champs de compétences. Quant à l’héritage des jeux, il ne se mesurera pas au prix du ticket de métro pendant quelques semaines estivales. Le vrai bilan s’effectuera dans quelques années, lorsque l’ensemble des infrastructures auront été livrées et pérennisées (ou non). Chaque citoyen pourra juger si ces jeux auront permis de connecter des territoires isolés, dynamiser des quartiers et faciliter les déplacements, et si les investissements publics consentis auront apporté un retour sur bénéfique pour la collectivité sur le moyen-terme.

METROPOLES 50 - LE THINK TANK DES METROPOLES
.png)